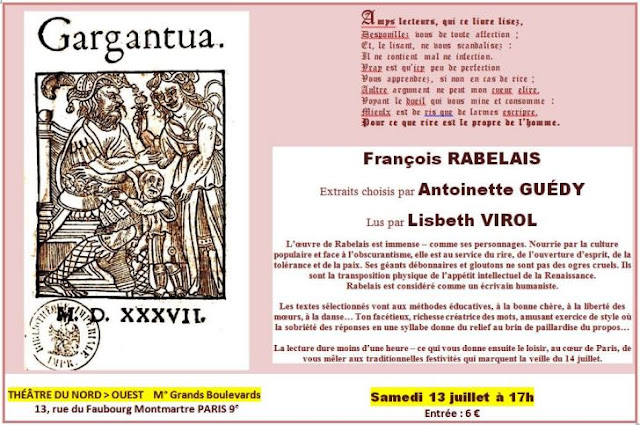Avec le temps, la légende d’un personnage s’impose aux générations suivantes. Sur le moment, le parcours est parfois semé d’embûches. En voici un exemple.
Alors qu’elle était encore en Pologne, Zapolska avait adapté
pour la scène une des pièces de Sarah Bernhardt
– « L’Aveu ». Désormais à Paris, elle écrit pour des journaux
varsoviens sur ce qui s’y passe.
Dans l’article ci-dessous, elle parle de Sarah. C’est pour y
évoquer un incident mais c’est un des rares témoignages d’un œil étranger à son
propos. Nous sommes en avril 1890. Le point de départ est d’informer ses
lecteurs polonais de ce qui se joue dans des théâtres parisiens pendant La
Semaine Sainte.
… Les églises rougeoient à cause des lumières qui
brûlent autour des tombeaux parés de fleurs. Des femmes vêtues du noir sont
recourbées sur leur prie-Dieu et elles prient. Venu de la chorale, le « Pro
peccatis » de Rossini s’élève vers la voûte sombre, ou encore le gémissement
du « Lacrimosa » de Mozart. A chaque fois qu’une des portes
d’église, enveloppées du velours, s’ouvre, une bouffée de l’air chaud du printemps s’y engouffre,
ainsi qu’un peu du brouhaha de la rue – ce brouhaha si caractéristique de
Paris. Les femmes qui priaient détournent la tête et, du dessous de leur
voile orné d’une mouche, jettent un regard sur le rayon de lumière qui vient
de se poser sur le sol. Ci et là, j’aperçois le profil aristocratique d’un
homme appuyé contre une colonne, ou la silhouette svelte d’une femme qui émerge
avec un bruissement de jupon en soie.
A Boulogne-sur-Seine, Monsieur Dardet, le maître de chapelle,
a dirigé les « Sept paroles du Christ » de Deslandres. A l’église
Saint-Séverin, le « Stabat Mater » de Mauger remplissait l’air. Et à
L’Opéra-Comique, Pergolèse, Bach et Haendel ont enchanté l’assemblée par le
faste de leur musique. Mesdames Simonnet, Nardi et Deschamps, toutes vêtues du
blanc, ont chanté les « Trois Anges » de Mendelssohn. Et le « Stabat
Mater » de Pergolèse, la plus belle des musiques terrestres, arrachait
l’âme vers le pays de l’extase.
Au Conservatoire national, Paderewski a dirigé un concert
consacré à Schumann. Au Châtelet, de belles interprètes de l’opérette et de
merveilleuses ballerines, après avoir charmé les spectateurs dans leurs
costumes couleur arc en ciel, ont cédé la place à Gounod qui, de sa baguette de
chef d’orchestre, a fait entrer Madame Krauss, Mademoiselle B. Montaland, Pauline
Viardot et d’autres. Tous les concerts, même ceux où se produisent des
cancans, ont donné le « Concert spirituel », et jusqu'aux Folies
Bergères qui sont restés fidèles à la tradition. Ce fut une véritable
« semaine des mélodies ».
Magnificence qui a pourtant été perturbée par l’exécution de
la « Passion » de Haraucourt, qui devait avoir lieu à l’Odéon avec la
participation de Sarah Bernhardt. Monsieur Porel (acteur et directeur de
l’Odéon) avait reculé en raison de la perspective d’un résultat incertain pour
cette manifestation. Monsieur Lamoureux (chef d’orchestre à l’Opéra-Comique) a
saisi au vol l’opportunité de présenter aux parisiens une chose nouvelle, qui
agirait sur leurs sens. Lorsque j’ai acheté
le billet pour ce spectacle, j’ai eu l’intuition que ce serait « un
four ».
Le Cirque d’Hiver où devait avoir lieu « La
Passion » est une grande bâtisse, construite sans aucune considération
pour ce qui est de l’acoustique. Il
était donc facile de prévoir que la voix de Sarah, qui déjà avait eu du mal à
se faire entendre dans «Jeanne d’Arc » et qui avait été inaudible lorsque
l’orchestre jouait dans la scène du couronnement, irait se perdre sous l’énorme
voûte du Cirque.
La partie musicale du concert s’est déroulé correctement. Le
Cirque était noir de monde. Lorsque Sarah est apparue, pour lire son rôle,
trainant derrière elle les plis d’une robe blanche en laine, style Byzance, la
foule s’est tue, se préparant à un festin spirituel. Sarah s’est assise, ayant
à sa droite Monsieur Garnier et à sa gauche Monsieur Bremont (Pilate, Kifas,
Judas). Derrière eux, la magnifique stature de Talazac, qui venait de recevoir
une ovation de tout l’auditoire, après avoir chanté l’air de Méhul. Sarah
commence enfin à lire.
Nous entendons le bruissement d’une mouche. On n’arrive pas à
comprendre un seul mot. Garnier lui
donne la réplique, le bruissement devient un peu plus fort, mais à peine. De la
foule s’élève une clameur : « Plus fort ! » Sarah
hausse les épaules et continue de bruire. Le public parisien est inflexible. Il
veut être bien servi pour son argent. Commence un vacarme indescriptible. – « La
musique ! », crient les spectateurs en se penchant au-dessus des balustrades.
Sarah arrête d’émettre des sons et… commence à pleurer.
Monsieur Haraucourt traverse alors l’arène en courant, comme
une bombe, et tâche calmer le public qui s’en amuse. En vain ! Il agite les
bras, son chapeau, mais le public ne veut pas de la « Passion », il ne
veut pas de vers, il ne veut pas de Sarah… Il s’en tient à crier :
« « La musique !».
Enfin les acteurs quittent l’estrade et Monsieur Lamoureux fait
signe à l’orchestre de commencer à jouer « Parsifal ».
J’avoue que j’en avais assez de ce spectacle mais le public, se
contentant de pouvoir entendre des percussions, s’est plongé dans l’écoute… de
Wagner.
Traduction de
Lisbeth Virol. Retouches par Arturo Nevill.